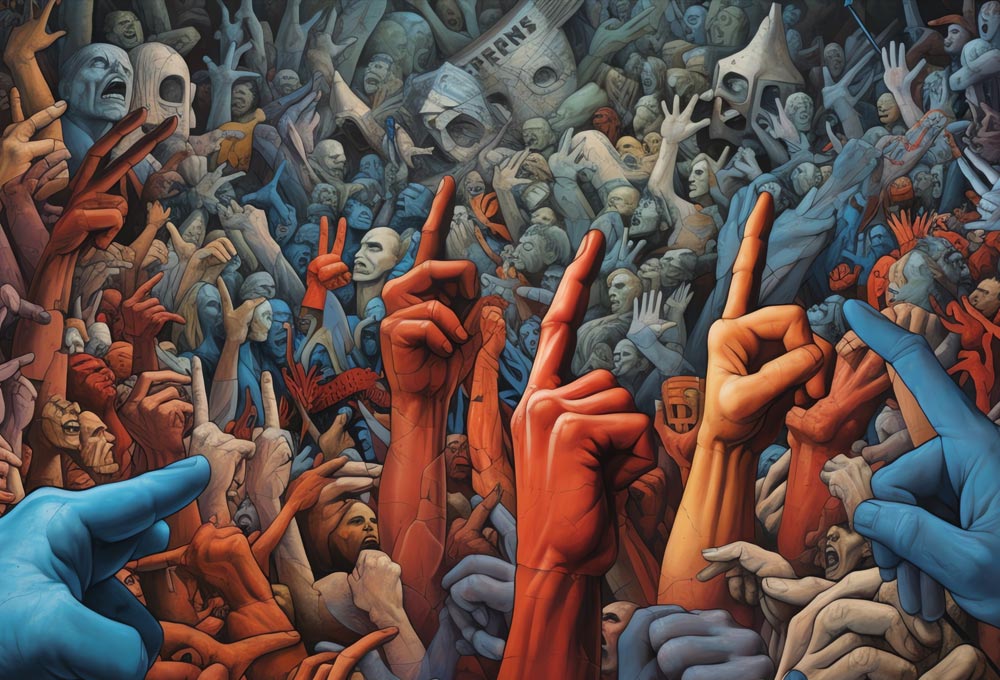La révolution de 1789 a imposé la reconnaissance de l’égalité de tous les citoyens et de leur liberté mais l’égalité ne peut véritablement exister qu’entre personnes jouissant de conditions sociales, économiques et culturelles proches, situation non réalisée à l’époque. La révolution n’a donc décidé que de l’égalité juridique des citoyens, valeur fondamentale mais abstraite.
Les deux siècles suivants ont permis de nombreux progrès pour sa concrétisation, tant sur les plans politique, avec l’établissement progressif du suffrage universel (suppression du cens en 1848, vote des femmes en 1944), qu’économique, grâce au partage des fruits de la révolution industrielle et de la société de consommation, culturel avec l’école pour tous, sociétal avec l’aide juridictionnelle ou le droit à l’avortement et, au cours des dernières décennies, l’exigence d’égalité entre sexes.Même l’exposition aux risques est devenue plus égalitaire avec le système sanitaire qui donne accès aux soins à tous et les armes nucléaires qui ne font aucune différence entre les hommes.
Mais le progrès semble s’être arrêté.
La société se fractionne, les revenus les plus bas régressent ou stagnent, les inégalités s’accroissent, la durée de la scolarité s’allonge mais les résultats atteints reculent et l’illettrisme progresse… Le risque sanitaire revient dans les déserts médicaux, la manipulation des électeurs par les réseaux sociaux fausse les résultats des votes…
La démocratie, malgré l’appareil médiatique qui en fait quotidiennement l’éloge, achoppe à constituer un gouvernement stable.
Atteinte des limites du modèle et/ou spasmes préparatoires à l’avènement d’un nouveau régime ?
L’égalité politique a été comprise comme une participation de tous au pouvoir et la fin des décisions imposées. Ce n’est pas possible pour tous dans une société hétérogène où existent de nombreux groupes aux convictions et intérêts divergents, souvent même opposés.
En démocratie, les décisions sont prises à la majorité, mais dans de nombreux cas, la minorité à laquelle elles sont imposées éprouve autant de ressentiment à l’égard de la majorité que si elles étaient prises par un quelconque autocrate. De plus, dans une démocratie représentative, la majorité dans un vote des parlementaires ne répond pas même aux désirs de 50 % des électeurs : les élus sont choisis sur la base d’un programme succinct et plus ou moins abstrait. Avant d’être élus, ils sont cooptés par des partis politiques qui prennent en compte non seulement les désirs de leurs électeurs mais aussi les contraintes liées à leur propre devenir, ce qui crée un hiatus évident entre représentants et représentés. Ils votent des lois qui, par construction, ne conviennent pas à l’opposition ni même à une partie de ceux qui les ont élus. Ainsi, alors que les décisions sont censées être prises en application du principe majoritaire, elles entérinent souvent des points de vue minoritaires !
De plus le champ des décisions ne cesse de s’élargir, ce qui multiplie les occasions d’insatisfaction : depuis 2000, le nombre d’articles des codes du commerce et de la consommation a triplé, ceux du travail et de la santé doublé, celui de l’environnement sextuplé pour atteindre près de 7 000 articles.
Si des compromis sont parfois possibles, ce ne peut être sur l’essentiel, ce qui peut conduire une partie de la population à souhaiter un régime autoritaire. Le stratège Grec Polybe constatait déjà au 2ème siècle avant JC que lorsque la démocratie tend vers l’anarchie – c’est-à-dire l’absence d’un pouvoir capable de décider pour la collectivité- un tyran est appelé pour y mettre fin.
Sur le plan économique, la volonté d’égalité a été modestement comprise comme un effort en vue d’éradiquer la pauvreté tout en limitant les grandes fortunes afin qu’elles ne soient pas une source de pouvoir politique. Si des progrès ont été faits dans ce sens, les objectifs n’ont pas été atteints et un mouvement inverse s’est même amorcé. Les grandes fortunes n’ont jamais été si importantes, ni en valeur absolue, ni en valeur relative, tandis que les revenus des 10 % les plus pauvres de la population ont régressé depuis 2008.
Sous l’ancien régime, les paysans étaient soumis à des corvées consistant à effectuer gratuitement des tâches indispensables à la collectivité ; aujourd’hui il faut des aides-soignants dans les EHPADs pour s’occuper des vieillards, des conducteurs de poids-lourds qui passent leurs vies coincés dans l’espace d’une cabine de camion et des milliers d’autres emplois tel celui d’éboueur dont tous ceux qui le peuvent se tiennent éloignés alors qu’il s’agit de fonctions indispensables à la cité. Ils sont rémunérés mais l’obligation économique demeure.
La technologie a conduit à de grands progrès dans l’acceptabilité des différents métiers. Mais la répulsion à l’égard des emplois les moins acceptés augmente, d’autant plus qu’ils sont fréquemment peu rémunérés. A leur manque d’attrait s’ajoute, pour ceux auxquels ils échoient, un sentiment de discrimination.
Le progrès dans l’accès à la culture, très positif en soi, nourrit des espérances de progrès économique et social dont la non-réalisation crée des frustrations, ce qui est fréquent car la structure des emplois ne le permet pas.
La comparaison avec le passé est également source de désenchantement :
Les diplômés d’autrefois, tel l’instituteur, jouissaient d’une position sociale relativement élevée dans une société où ils étaient rares. Ce n’est plus le cas du fait de la banalisation de leurs niveaux d’études et de revenu dans un monde où 92 % des bacheliers généraux accèdent à l’enseignement supérieur. L’ascenseur social qui a fonctionné pendant les trente glorieuses a profité peu ou prou à l’ensemble de la société ; ce mouvement général a cessé et fait place à des trajectoires personnelles de réussite ou d’échec.
Tous les êtres humains ont besoin d’être actifs mais veulent choisir leurs activités ainsi que le temps et les conditions dans lesquelles s’y livrer. Ils peuvent consacrer bénévolement de gros efforts à des activités comme le sport mais aussi dans d’autres domaines, la recherche scientifique par exemple, à laquelle Galilée, Darwin ou Lavoisier ont consacré leur temps et leurs ressources personnelles. Mais ils ne choisissent pas certaines activités essentielles pour la société que personne ne veut spontanément prendre en charge.
Ce que la politique ne conçoit pas peut cependant être rendu partiellement possible par la technologie. Tout comme la révolution industrielle a fait plus que toutes les théories sociales pour lutter contre la misère, l’intelligence artificielle et l’avènement de robots performants vont permettre, pour la première fois dans l’histoire, d’envisager la suppression de l’obligation de travailler en instituant un revenu universel de base.
Il y aura toujours des tâches dont la machine ne pourra se charger. Ainsi, prendre soin de personnes dépendantes sera de plus en plus facilité par la technique, pour le suivi automatique des données vitales par exemple, mais restera un travail humain pour l’essentiel.
Beaucoup de tâches seront reportées sur les consommateurs. Ce mouvement a commencé : il n’y a pratiquement plus de porteur dans les aéroports ni de caissière dans les supermarchés, de guichetier à la RATP ou de serveur chez McDo. Ce n’est plus le facteur qui apporte le colis mais le destinataire qui va le chercher au relais dépôt etc. Des applications numériques permettront d’aller plus loin en guidant le travail de l’utilisateur ou du consommateur. Le temps consacré à la préparation et aux conséquences de la consommation, qui absorbe déjà l’essentiel de la réduction du temps de travail obtenue depuis le début du 20ème siècle, va donc continuer à progresser.
Globalement cette nouvelle avancée de l’automatisation et le déport du travail sur les bénéficiaires directs de l’activité rendront possible la suppression de l’obligation de travailler pour raison économique.
Ce progrès tant espéré sera l’occasion de valoriser les apports qualitatifs, psychologiques et sociaux du travail et permettra de répondre à de nombreuses attentes actuellement insatisfaites tant par l’organisation actuelle du travail que par la société en général.
L’histoire de l’auto-entreprenariat éclaire les attentes à l’égard du travail : apparu comme un moyen de réduire le coût du travail de personnes que leur faible employabilité maintenait au chômage dans les conditions légales de rémunération et de taxes, il permet aujourd’hui de pratiquer nombre de métiers comme autant de professions libérales dont les membres choisissent leurs clients et négocient rémunération, horaires et conditions de travail. Si la majorité des emplois qu’il fournit sont encore modestes, on voit de plus en plus de cadres tenter l’aventure dans des statuts juridiques mieux adaptés.
Des citoyens formés et à peu près assurés de leur avenir ne veulent travailler que de la manière qui leur convient et quand cela leur convient, considérant qu’un avantage économique ne peut avoir comme contrepartie la perte de leur liberté : on voit ainsi de jeunes traders, royalement payés, abandonner leur emploi pour devenir artisans…
Comment la société peut-elle s’adapter ?
La contrainte, économique ou autre, a permis et permet encore de faire travailler les hommes mais avec une efficacité qui se réduit avec le temps, en particulier pour les tâches complexes, alors que certaines circonstances les amènent à faire spontanément d’incroyables efforts.
Liberté et autorité sont compatibles lorsque leurs territoires respectifs sont clairement et honnêtement définis : ainsi imposer à de jeunes médecins d’exercer et de vivre dans des endroits qu’ils n’ont pas choisis, sans qu’à un quelconque moment de leur cursus ceci leur ait été présenté comme une contrainte associée à leur choix de carrière est antidémocratique et aura de malheureuses conséquences : renforcement de la méfiance à l’égard de l‘État, accroissement des départs pour l’étranger de diplômés français devant être compensé par la venue de médecins venant d’autres pays…
A contrario, il serait concevable que tous ceux qui font de coûteuses études aux frais de l’État soient appelés, à leur entrée dans la vie professionnelle, à consacrer un certain temps à des travaux d’intérêt collectif pour valider leur statut de citoyen à condition que les choses soient claires au moment du choix de leur cursus, justifié et équitablement réparti.
De manière générale, pour que la société continue à progresser vers l’égalité et la liberté, le travail ne doit plus être considéré comme élément distinct de la vie en société : il n’y a pas la constitution d’un côté et le contrat de travail de l’autre : le travail détermine largement la position économique et sociale de la personne, ses possibilités de développement personnel, ses relations sociales, souvent sa santé, l’intérêt et le plaisir associés au temps qui passe. Il a aussi une influence importante sur l’habitat, la vie de famille, l’accès aux loisirs, etc. Pour la société, il est l’unique source primaire du financement de tous les objectifs qu’elle se fixe, qu’ils soient sociaux, culturels, militaires ou autres.
Le travail ne peut donc constituer une bulle isolée de l’environnement institutionnel mais la démocratie en tant que mode d’organisation de la vie collective ne peut se concevoir comme l’addition des désirs de chacun. Ce sont deux obstacles qui font de la démocratie une utopie, mais de grands progrès en direction de la liberté et de l’égalité ont été faits et peuvent l’être encore.
Admettre l’existence de limites est plus facile quand l’effort pour s’en rapprocher est réel.