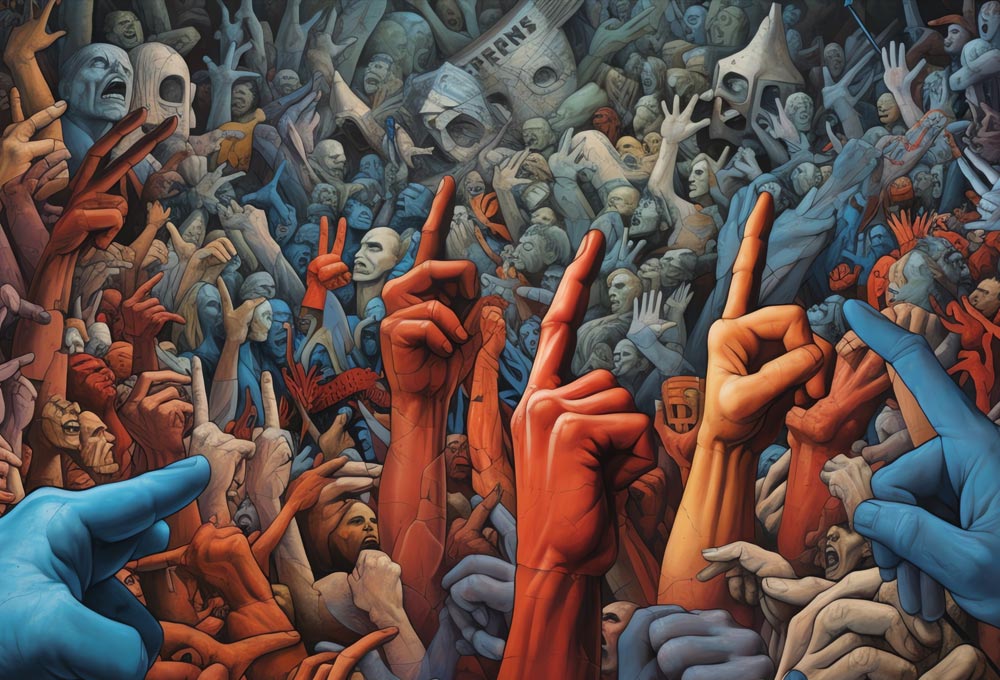Le champ du travail, défini comme la réalisation de tâches demandant un effort, se partage en trois sous-ensembles :
- Des tâches que beaucoup de personnes auraient plaisir à effectuer sans contrepartie économique si elles n’avaient pas besoin de gagner leur vie, ci-après désignées par le terme « souhaitées ». Il en existe beaucoup d’exemples dans la pratique des arts, des sports ou d’actions sociales mais pas seulement.
- Des tâches que certaines personnes peuvent accepter sans difficulté et qu’elles recherchent de préférence quand elles doivent travailler pour bénéficier d’un revenu mais qu’elles n’envisageraient pas de prendre en charge sans cette obligation : elles seront dites « acceptables ».
- Enfin, des tâches auxquelles personne ne souhaite se consacrer sans y être contraint par la force (esclavage, travaux forcés) ou un besoin économique fort qu’aucune alternative ne permet de satisfaire, ce sont les tâches « rejetées ».
Les frontières entre ces sous-ensembles ne sont ni nettes, ni stables, et différentes selon les individus.
Une activité donnée peut être considérée par certains comme appartenant au premier sous-ensemble tandis que pour d’autres personnes, elle sera seulement « acceptable » voir « rejetée ». Il en est ainsi du fait de tuer des animaux par exemple qui peut être considérée comme un sport ou un divertissement (chasse, corrida, …) un travail « acceptable » (boucherie) ou une activité inacceptable pour des raisons religieuses ou de sensibilité.
L’évolution des techniques de production a multiplié les tâches « acceptables » en réduisant les efforts physiques et les risques liés à certains travaux et en améliorant les conditions dans lesquelles ils se déroulent (hygiène, sécurité, confort…). Malgré ces progrès, une part importante des besoins humains ne peuvent encore être satisfaits qu’à travers des emplois rejetés et le progrès économique en crée de nouveaux puisque accéder à un niveau de vie supérieur signifie se débarrasser sur d‘autres de corvées qu’on ne veut plus faire : le développement des emplois de maison, des livraisons de repas à domicile par exemple, le démontre.
Parallèlement, la démocratie s’est organisée en France autour des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité ; l’égalité ici évoquée est l’égalité juridique, celle des droits des personnes. La vie concrète permet de constater qu’en l’absence de moyens économiques, l’égalité juridique ne peut se concrétiser. La liberté et la fraternité sont également impactées par l’existence de contraintes économiques fortes non partagées par tous.
Il eut été légitime que la déclaration des droits de l’homme de 1789 ajoutât la prospérité aux principes d’égalité, de liberté et de fraternité, mais la révolution industrielle était encore trop jeune pour que l’idée de développement et de prospérité s’imposât aux esprits ; certes, il était connu que les sociétés pouvaient être plus ou moins prospères et les années plus ou moins bonnes, mais cela était considéré comme une donnée de la nature : le travail permettait de faire produire la terre en fonction de ses caractéristiques et des aléas du climat, mais personne n’imaginait qu’une amélioration continue de la productivité puisse changer substantiellement le destin des hommes. Le progrès éventuellement possible résidait davantage dans une meilleure répartition de l’existant que dans la multiplication de ce dernier. Les riches ne pouvaient exister que grâce à une répartition en leur faveur imposée par la force et la tradition et les utopies visaient l’amélioration du sort du plus grand nombre par une répartition forcée plus égalitaire.
Finalement, la révolution industrielle et le capitalisme qui a permis son déploiement, ont partiellement répondu à l’exigence de prospérité pour tous dans l’ensemble national. Sur le plan du travail, une multitude de métiers nouveaux sont apparus, moins contraignants physiquement, exigeant plus de compétences, comportant la mise en jeu d’équipements coûteux et complexes impliquant la responsabilité de l’opérateur. Leur diversité les rend « acceptables » à un large éventail de citoyens.
Le développement général et la productivité propre à chacun de ces emplois qualifiés ont permis l’émergence puis le développement d’une nouvelle composante de la bourgeoisie dont l’importance numérique s’est trouvée fortement accrue.
- La production de services, comme celles de produits matériels, se réalise par le biais de tâches qui peuvent être « souhaitées », « acceptables » ou « rejetées » selon la terminologie définie précédemment. Les tâches « rejetées » le sont d’autant plus qu’elles symbolisent un rapport entre maîtres et serviteurs que le développement de la démocratie a conduit à combattre.
- Au fil du temps, la nature des produits et services demandés par la nouvelle classe intermédiaire a évolué pour ressembler de plus en plus à celle de la bourgeoisie, c’est à dire en faveur de services à fort contenu travail (santé, loisirs, logistique…)
Cette évolution conduit à une impasse dans la mesure où l’augmentation du nombre de consommateurs s’accompagne de son corollaire, la réduction du nombre de ceux qui sont contraints d’en faire leur métier.
La démocratie repose au fond sur une aporie : la revendication à l’égalité doit être entendue comme l’aspiration à partager un statu supérieur et non un sort moyen que beaucoup dépassent déjà sans en être satisfaits, mais si tous pouvaient également accéder à la même prospérité, les satisfactions qui en sont attendues ne pourraient plus se concrétiser.
Afin d’éviter le choix entre moins d’égalité et l’existence des conditions que chacun espère à travers elle, on recourt de manière croissante à une main d’œuvre immigrée dont le droit de résider est, de fait, subordonné à l’acceptation des métiers « rejetés ».
Le phénomène pourrait être provisoirement ralenti par la disparition massive d’emplois « acceptés » en raison de l’avènement de l’intelligence artificielle. Comme toute nouvelle technique de production majeure, elle va provoquer, dans un premier temps un déclassement de ceux dont les emplois disparaitront, en l’occurrence cette petite et moyenne bourgeoisie nouvelle.
Au-delà, cette évolution rappelle que si la richesse se définit comme la propriété d’un volume important de biens, sa dimension principale est le pouvoir qu’elle donne sur d’autres hommes.
L’espérance démocratique ne peut donc être qu’un objectif. Tout progrès fait dans sa direction est accompagné de reculs par ailleurs. La tyrannie en apporte la preuve a contrario, en évitant cette difficulté pour certains, et en en reportant le poids sur tous les autres.
Cet article est illustré par une huile sur toile de Jean-François Millet exposé au musée d’Orsay : Des Glaneuses – 1857, huile sur toile, H. 83,5 ; L. 110,0 cm. Donation sous réserve d’usufruit Mme Pommery, 1890. –