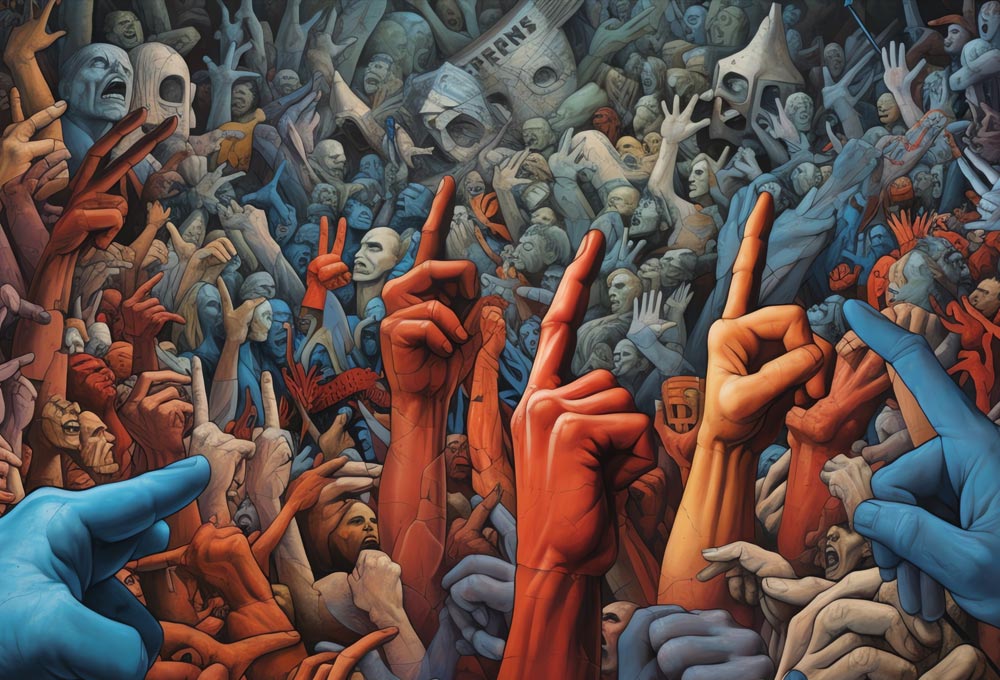Les 8 milliards d’habitants de notre planète se partagent pour moitié entre 6 pays : Inde, Chine, Indonésie, États-Unis, Pakistan et Brésil, et, pour l’autre moitié, entre 190 pays de moindre importance. Parmi eux, vingt-sept états d’Europe ont décidé de s’unir pour créer une entité politique et économique efficace et pérenne et s’interrogent sur l’élargissement de leur Union.
Historiquement, les grands empires bâtis par la force et la contrainte se sont avérés fragiles en raison de leur mode de constitution et de leur hétérogénéité, les parties conquises non assimilées se révoltant et finissant par recouvrer leur indépendance.
Des États, de moindre dimension, se sont constitués, comme les empires, à partir d’un centre auquel ont été agrégées progressivement, le plus souvent par la force, des régions voisines. Ce fut notamment le cas de la France. Avec le temps s’est opérée en leur sein une homogénéisation des populations et l’unification a fini par être acceptée. La paix a ensuite régné à l’intérieur de leurs frontières, même si des velléités d’indépendance subsistent par endroit et rappellent le passé.
La création de l’Union Européenne repose sur l’idée que des pays qui n’ont jamais accepté de faire partie d’un même empire pourraient accepter de se comporter volontairement comme membres d’un même ensemble politique et cesser de se faire la guerre, à l’image des parties d’une même nation.
Pari gagné jusqu’à aujourd’hui avec l’homogénéisation des institutions politiques et le brassage des cultures. Ce n’est toutefois pas une garantie de paix totale, car une grande hétérogénéité subsiste entre le Nord et le Sud, l’Ouest et l’Est. La guerre de Sécession aux États-Unis nous le rappelle.
Les petits pays étant fréquemment considérés comme une proie et assaillis par leurs voisins plus puissants, les pays européens, pris isolément, seraient désormais vulnérables face aux géants que sont devenus la Chine, les États-Unis et l’Inde : à l‘intérêt de réduire les conflits entre eux, leur Union ajoute celui de constituer un ensemble capable de faire face aux plus grands.
Mais les empires se font aussi la guerre et un conflit local, à l’autre bout du monde, par exemple entre la Chine et Taïwan, pourrait être à l’origine d’une guerre mondiale à laquelle l’Europe serait amenée à prendre part, alors qu’un pays européen seul pourrait rester à l’écart. Même situation avec l’Ukraine. Mutatis mutandis, c’est ce qu’ont vécu les régions constituant les États membres.
Le second objectif assigné à la création d’une Europe unie était la croissance économique.
Que nous enseigne la comparaison entre petits et grands États ?
On constate, si on classe l’ensemble des pays selon leur PIB par habitant, que les États-Unis, le plus riche des grands pays, se situe au 7ème rang, l’Allemagne au 19ème, la Grande-Bretagne au 21ème et le Japon au 32ème rang (chiffres 2023). L’avantage de la taille ne semble donc pas déterminant. De grands pays comme les États-Unis ou la Chine pourraient vivre en autarcie. Ils y perdraient, mais pourraient le faire. Un petit pays est condamné à importer une part d’autant plus grande des produits dont il a besoin qu’il plus est petit. La possibilité de choisir librement les fournisseurs les mieux placés dans le monde au lieu de devoir consommer les productions locales est un facteur favorable au niveau de vie des habitants, mais il faut pouvoir les payer. Les petits pays se distinguent de ce point de vue selon qu’ils disposent ou non de caractéristiques qui leur donnent un avantage compétitif dans les échanges internationaux – existence de ressources naturelles, sites touristiques, activités construites (finance offshore, fiscalité etc..).
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, ce ne sont pas les producteurs de pétrole et de gaz qui mènent la danse, le Qatar n’arrivant qu’en 6ème position, mais ceux qui ont bâti leur compétitivité sur des facteurs d’attractivité voulus et créés (Luxembourg, Irlande, Suisse, Singapour…). Ceux qui n’ont pas une spécialisation attractive figurent au contraire parmi les plus pauvres.
Revenons à l’Europe économique : en son sein les pays pauvres, petits ou moyens, peuvent espérer des transferts de richesses en leur faveur : subventions, libre circulation des hommes et des marchandises leur permettant de concurrencer les pays riches de l’Union qui financent leur rattrapage tandis que les pays plus riches sont au contraire pénalisés d’autant que leur patrimoine industriel est vieillissant (on retrouve ici ce qui s’est passé en Europe avec le plan Marshall après la dernière guerre : l’Allemagne détruite a bénéficié d’aides pour se constituer un appareil productif plus moderne que celui de ses vainqueurs). Comme l’Europe n’a de cesse de s’agrandir au profit de nouveaux petits pays pauvres, que par ailleurs la politique économique de chacun est désormais contrainte, les pays les plus grands et les plus prospères de l’Europe assument et assumeront un vrai handicap tant que les pays pauvres n’auront pas un niveau de vie comparable au leur.
Sur le plan culturel, considéré par les fondateurs comme important à long terme pour la création d’un esprit d’appartenance à une même communauté, des progrès ont été faits grâce à la facilité des échanges, l’abolition des frontières, la création d’un marché intérieur, le tourisme, la monnaie unique et les programmes culturels type Erasmus. Malgré une politique culturelle plutôt protectionniste, l’Union européenne a surtout constitué un boulevard pour l’américanisation. Le fait que la langue commune soit l’anglais a facilité cette évolution que les petits pays n’auraient pu éviter mais que les pays moyens comme la France pouvaient espérer contenir. Il se pourrait cependant que cette évolution favorise paradoxalement le vivre ensemble comme en Inde.
En conclusion, vaut-il mieux pour un petit ou moyen pays gérer soi-même son destin ou être membre effectif et consentant d’une Union et, en particulier, de l’Union Européenne ? Sans surprise, la réponse dépend des spécificités de chacun.
Bien que petite, la Suisse a préféré rester hors de l’Union. Elle figure parmi les pays riches et a conservé sa culture : sa neutralité ainsi que sa situation géographique semblent lui donner des probabilités de paix supérieures à celles de l’Europe, concernée par tous les conflits du monde. Elle semble avoir fait le bon choix.
Pour les États d’Europe centrale, plutôt pauvres, qui ont connu l’intégration forcée dans l’empire soviétique, l’Europe représente une protection militaire, une perspective d’enrichissement économique et une ouverture culturelle. C’est pour eux une opportunité attrayante. La Grande Bretagne a tiré profit de l’Europe puis s’en est retirée, privilégiant des liens moins contraignants avec les États-Unis, son appartenance à l’OTAN, la sauvegarde de sa culture et de sa conception libérale de la vie collective… Ce choix semble à ce jour lui avoir été défavorable, mais l’histoire n’est pas terminée.
L’avenir n’est pas déterminé par la seule taille : à court et moyen terme les nations performantes, même petites comme Israël, ont intérêt à garder la maîtrise de leur destin même si des alliances leur sont indispensables. Celles qui sont moins performantes, en raison d’un héritage historique ou d‘une culture moins orientée vers l‘efficacité, ont intérêt à s’unir.
À long terme, les populations et la richesse ont vocation à se concentrer dans certaines zones, grandes métropoles et régions disposant d’une dynamique particulière, ce qui n’est guère possible dans un univers cloisonné. L’union permet de participer efficacement à cette évolution au grand dam des régions abandonnées et des pays dans lesquels elles se situent.
Tout choix est un pari, le plus rationnel peut s’avérer perdant et le plus improbable gagnants ; les meilleurs atouts sont toujours le sens de l’intérêt national, la détermination et le courage.