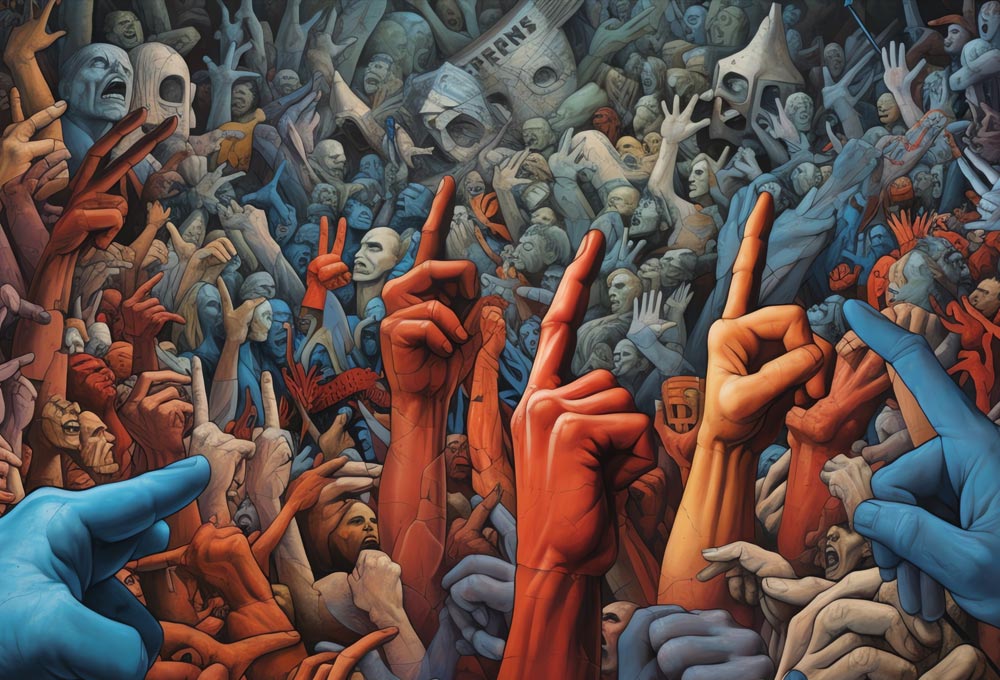La complexité du monde est une des causes de la médiocrité ressentie de la gouvernance de nombreux pays, mais il faut reconnaître que ce qui serait objectivement réalisable pour avoir de meilleurs résultats n’est pas fait dans nombre de cas. En France, l’État ne s’applique pas ce principe de base reconnu par la sagesse populaire selon lequel il faut s’efforcer de prévoir pour bien gouverner.
On peut l’illustrer par le numerus clausus appliqué depuis 1983 à la formation des médecins, considérés comme trop nombreux à l’époque. Quarante ans après, une grave pénurie de praticiens menace la santé publique et a déjà conduit à nombre d’expédients pour éviter la catastrophe. Or, il était extrêmement simple de prévoir que les cohortes jugées trop nombreuses à l’époque allaient un jour prendre leur retraite et que le nombre total de médecins allait baisser, justifiant un élargissement des quotas au moins 10 ans avant. Il n’était pas difficile, non plus, de prévoir que la population allait augmenter. La France compte 8 millions d’habitants de plus et un simple suivi régulier de l’évolution démographique aurait permis de limiter les dégâts. La même constatation aurait pu être faite à propos de l’espérance de vie qui s’est allongée de 8 ans sur la période, entraînant une forte augmentation des maladies chroniques caractéristiques du grand âge. D’autres tendances, plus difficiles à projeter, auraient pu de même faire l’objet d’appréciations périodiques pour évaluer le chemin parcouru. Par exemple la féminisation de cette profession, l’évolution du rapport au travail dans la société en général et son influence sur le personnel soignant ou encore les conséquences de la multiplication des spécialités, etc… À l’évidence, l’absence de prévision n’a pas permis une gouvernance efficace.
Aujourd’hui la France se trouve confrontée à un difficile problème de logement. Est-ce le résultat d’un orage imprévisible ? Évidemment pas ! La population augmente continûment depuis 75 ans. Elle se déplace, abandonnant des habitations en zone rurale pour se concentrer en ville et dans les zones littorales. La décohabitation se poursuit, l’élévation croissante du niveau de vie, même très ralentie, alimente un désir d’espace supplémentaire. En conséquence les besoins augmentent. L’offre stagne ou se réduit du fait de l’obsolescence naturelle du parc et de l’évolution des usages et des localisations. Elle se réduit du fait des décisions publiques d’interdire la location de biens insuffisamment isolés. Elle se réduit du fait des contraintes financières que l’État fait peser sur les bailleurs sociaux. Elle se réduit parce que les taux d’intérêt à long terme, basés sur l’hypothèse d’une poursuite à haut niveau de l’inflation, sont trop élevés et découragent les ménages dont les revenus sont désormais insuffisants. Elle se réduit parce que les détenteurs d’une épargne privée sont pénalisés, lorsqu’ils investissent dans la pierre, par une fiscalisation excessive (IFI, impôts sur le revenu et charges foncières) qui confisque la totalité du rendement courant, alors même que les perspectives de valorisation ont fait place à des probabilités de perte à court et moyen terme. Elle se réduit en raison de la prolifération des normes et règlements. Toutes les causes de la crise pouvaient être donc anticipées.
Ces exemples démontrent l’inconséquence de vouloir diriger sans s’efforcer de prévoir et celle-ci s’illustrera malheureusement encore à l’avenir. Les problèmes liés à l’arrivée des premières classes d’âge du baby-boom au terme de leur espérance de vie à partir de 2025 l’illustreront.
Lorsque la prévision est entachée de trop d’incertitudes, il est possible d’élaborer des scénarii pour mettre très tôt en évidence les points de vigilance afin de ne pas être pris au dépourvu. C’est le cas, par exemple, pour l’avenir du travail rendu incertain par les influences opposées du vieillissement de la population et du développement technologique, dont l’intelligence artificielle.
Après la Seconde Guerre Mondiale a existé en France un Commissariat au plan qui a joué un rôle significatif dans la reconstruction et la modernisation de la France. Il a été supprimé en 2006 au motif que l’époque n’était plus à la création de grandes infrastructures publiques et que le marché était mieux placé que quiconque pour répondre aux aspirations du consommateur. À supposer que cela soit, le fait que plus de la moitié du PIB passe par les mains de l’État montre que cette solution ne pourrait être que partielle.
Par ailleurs si le marché peut répondre efficacement à beaucoup de besoins, il peut le faire en produisant ou en important. Les conséquences pour l’économie française ne sont pas indifférentes comme on peut le voir actuellement avec l’État de dépendance dans lequel s’est placé le pays pour de nombreux biens. La France a pu perdre 50% de son industrie sans réaction comme elle a laissé se développer des déserts médicaux. L’agriculture, longtemps choyée par les décideurs publics et tout aussi stratégique que l’industrie, tend à prendre le même chemin.
Le court et le long terme ont bien souvent des exigences contradictoires de sorte que les fruits à long terme d’une focalisation exclusive sur le court terme sont toujours malheureux.