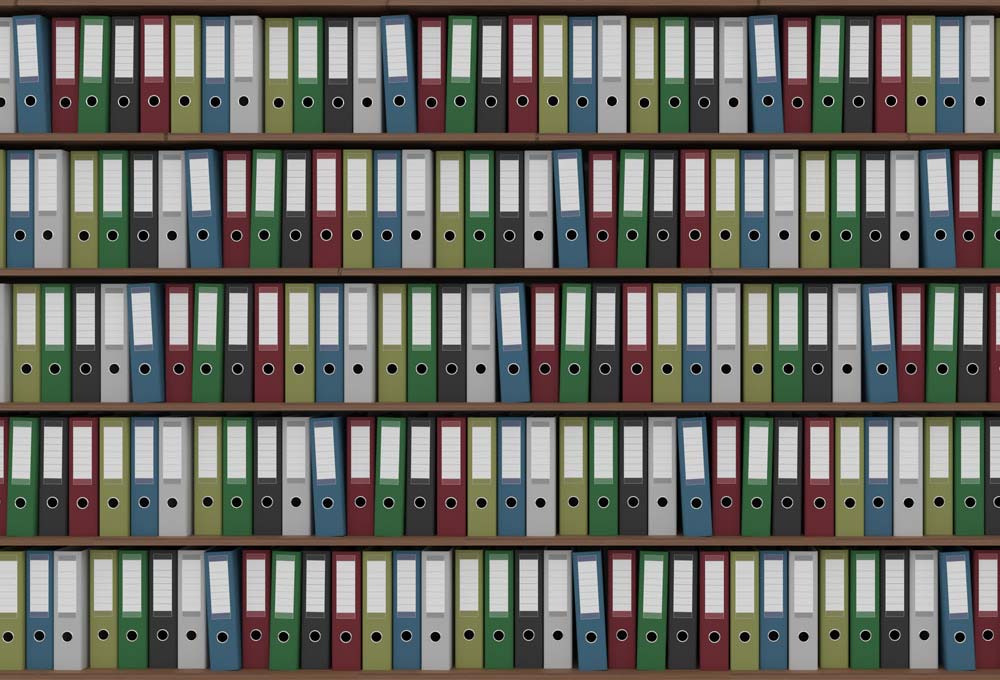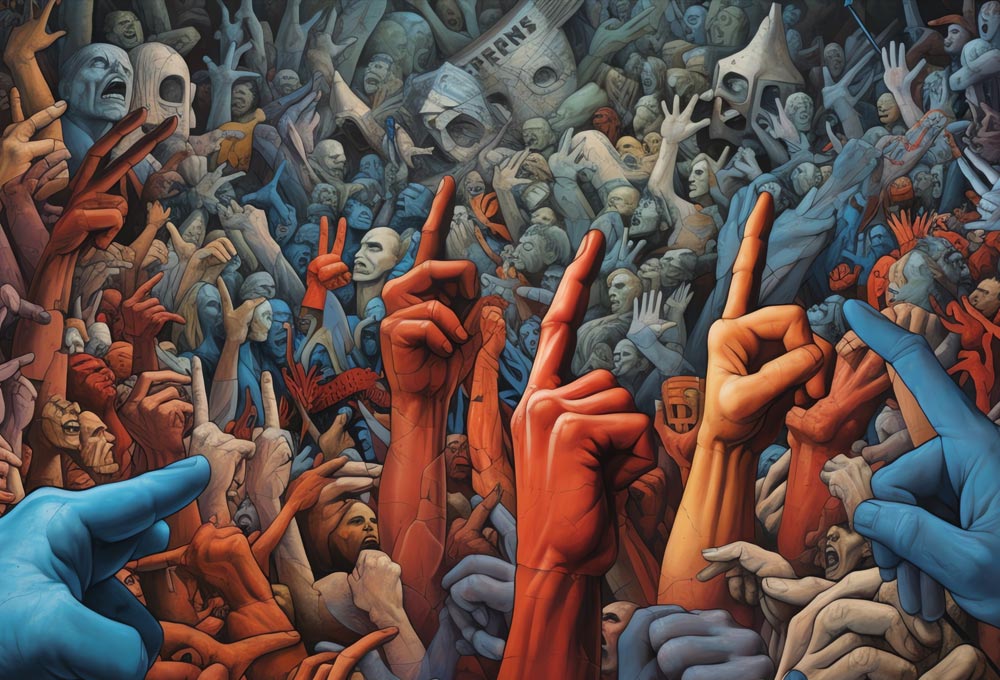Un consensus existe désormais sur le fait qu’une chape bureaucratique pèse sur notre pays et menace de l’asphyxier. Pour autant, il y a peu de recherches sur les causes qui ont conduit à cette situation et donc sur les éventuels remèdes.
Le président Sarkozy avait prévu dans son programme la réduction du nombre de fonctionnaires : ce fut un échec.
Le président Hollande a créé une commission de la simplification : ses résultats ont été très modestes et inférieurs au nombre de procédures nouvelles créées pendant le bref temps de son existence.
On parle à nouveau d’une commission : Pourquoi ses résultats seraient-ils meilleurs ?
Pourtant un mouvement de l’ampleur de la bureaucratisation, qui s’est développé sur des décennies, auquel ont participé des générations de décideurs, ne peut résulter ni de la seule mauvaise volonté de ceux-ci ni de leur incompétence. De plus, c’est une situation qu’on retrouve dans de nombreux pays : l’Amérique elle-même, pourtant hostile depuis son origine au pouvoir de l’État, n’a pas su éviter une certaine dérive dans ce sens à laquelle le Président Trump prétend mettre un terme.
Le phénomène n’est propre ni à la France ni à l’époque moderne : les démocraties populaires en ont donné un exemple caricatural qui a conduit nombre d’observateurs à penser que la bureaucratie était un moyen de contrôler la société qui leur était indispensable.
C’était le cas mais pas nécessairement la seule ni première cause.
Au départ, les démocraties populaires poursuivaient une utopie qui présentait beaucoup d’attraits aux yeux d’une bonne partie de l’humanité et les utopies simplement imaginées, comme celles de Thomas Moore ou de Campanella, laissaient déjà transparaître la nécessité de contraindre les individus pour leur imposer le comportement nécessaire au bonheur collectif dont elles souhaitaient l’avènement. Les démocraties populaires ont été exemplaires dans leurs motivations, leur bureaucratie kafkaïenne et leur échec économique et social ainsi que dans la brièveté relative de leur existence.
On trouve partout et en tout temps des exemples démontrant que la recherche du bien aboutit à l’effet inverse quand elle s’appuie sur la contrainte : ainsi Turgot pensait que le mauvais approvisionnement en grains de Paris à sa nomination comme ministre de LOUIS XVI était largement dû à 3 siècles de réglementations qui en avaient rendu le commerce difficile et coûteux et avaient ouvert un espace à la contrebande, laquelle aggravait la situation.
En ne tombant pas dans le bloc communiste après la deuxième guerre mondiale, la France n’a pas connu le sort des démocraties populaires mais a poursuivi sur la même voie et ne pourra échapper à la même issue sans un changement profond de cap ou, au minimum, un ralentissement de la bureaucratisation pour en harmoniser le rythme avec celui de la création de richesses.
L’évolution des sociétés vers la prospérité s’est accompagnée d’une hétérogénéité croissante des conceptions du bien ; à la lutte contre la pauvreté, l’ignorance et la maladie, ont succédé une multitude d’objectifs de plus en plus focalisés, défendus par des associations dont chacune promeut la mise en œuvre de réglementations nouvelles. Les médias dont la vocation est de mettre en lumière les dysfonctionnements de la société et leurs victimes, les alimentent en nouvelles causes et l’Etat les finance et les écoute. Les objectifs les plus généraux, de caractère social, cèdent ainsi la place à des objectifs de moindre ampleur mais infiniment plus nombreux puisque chaque type d’activité, chaque groupe social, chaque individu et même, au-delà, la gent animale et l’environnement, dans leurs multiples composantes, doivent être protégés des risques que la nature et leurs contemporains leur font courir. On parle aujourd’hui même par exemple d’imposer, à la demande d’associations de cyclistes, l’ouverture des portières de voiture avec la main droite !
Les grands objectifs font l’objet d’une adhésion large, les objectifs focalisés, parce qu’ils n’intéressent pas tout le monde ou reposent sur des convictions particulières, sont défendus par des groupes limités susceptibles d’entrer plus fréquemment en conflit les uns avec les autres : ainsi le besoin des habitants d’une région de se désenclaver peut être mis en échec par le souci de protéger la niche écologique de scarabées dorés ou bien encore les règles protégeant l’environnement prescrivent d’économiser le papier et celles relatives à la protection des consommateurs conduisent à en donner de plus en plus pour les alerter sur tous les dangers qui peuvent se cacher dans la consommation ou l’utilisation d’un produit. On peut trouver une infinité d’exemples de ce type.
Un marqueur de cette évolution est celle du nombre d’avocats en France, passé de 20.000 à77.000 entre 1980 et maintenant. C’est un détournement de ressources de la production quantitative au profit d’espérances de progrès qualitatifs.
Si le désir d’aller vers une société meilleure amorce le mouvement, les entités chargées de la mise en œuvre s’autonomisent et suivent ensuite leur propre logique.
La caste des fonctionnaires, dont l’objectif assigné et les valeurs largement partagées par ses membres visent la recherche du bien commun, joue dans ce sens, d’autant qu’elle fournit une grande partie des dirigeants des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire.
La communauté Européenne, avide de bien faire, en rajoute ; le coût des normes qu’elle impose à l’industrie automobile commence à rendre l’achat d’un véhicule neuf inaccessible à une couche de la population qui y avait accès. Les charges dues à la régulation de l’industrie chimique ont été multipliées par 3 en 10 ans…
Plus les thèmes de l’intervention publique se focalisent, plus les structures qui en ont la charge se spécialisent et une structure spécialisée fait ce qu’elle sait faire : plus de règlementation dans son domaine de responsabilité.
Globalement, malgré des excès, des erreurs et des aberrations dus à la logique des structures censées accompagner et promouvoir le progrès, on peut considérer que la bureaucratisation a fait avancer dans le bon sens. Elle est cependant à l’origine de problèmes mortifères pour les sociétés lorsque les ressources économiques qu’elle absorbe ou empêche de produire croissent plus rapidement que celles dégagées par la productivité, ce qui est devenu le cas.
Il ne faut pas renoncer à rechercher l’amélioration des conditions d’existence, mais limiter les ressources qu’elle absorbe au détriment de ses propres finalités et poursuivre la quête de la croissance dont la productivité est le moteur.
Il suffit d’un regard en arrière pour s’en convaincre : le PIB par habitant en France a été multiplié par 6 depuis 1950 ce qui a permis d’améliorer le système de soins, raccourcir le temps de travail, accéder à un certain confort et allonger l’espérance de vie, etc.
Vouloir atteindre le même résultat par le partage de la maigre richesse existant à l’époque aurait été impossible ; de plus, comme dans les pays de l’Est, il aurait fallu utiliser la contrainte à l’encontre de ceux qui auraient été dépossédés. L’esprit d’entreprise et le goût du travail auraient disparu en même temps que les facultés d’investir et de prendre des risques. La richesse et la liberté auraient été perdues.
Pourtant, l’illusion subsiste. L’exemple du droit au logement l’illustre : c’est une avancée sociale légitime dans une société relativement opulente, mais qui n’a de sens que s’il y a des logements, sinon ce n’est qu’une source de frustration supplémentaire. Vouloir accueillir tout le monde dans les logements existant n’apporterait qu’une petite partie de la solution et beaucoup de contraintes, donc d’arbitraire et de privation de liberté et aggraverait la situation. Vouloir imposer aux jeunes médecins leur futur lieu d’exercice et de vie, comme on l’envisage aujourd’hui, c’est vouloir améliorer une situation créée par le numérus clausus (déjà une mesure d’autorité dont le résultat est une pénurie) par le recours à la contrainte, et mettre en place les conditions d’une accélération de la dégradation : lorsque Napoléon a eu besoin de bons officiers, il a créé Polytechnique et permis à des jeunes qui, pour beaucoup, n’auraient pu financièrement faire ce type d’études, de devenir des cadres d’élite engagés à servir l’Etat dans les missions que celui-ci leur assignait: tout le monde y a gagné. L’incitation financière, la stimulation sociale et la liberté de choix des citoyens ont fait mieux que n’importe quelle contrainte.
La liberté n’est pas un acquis définitif et on constate qu’elle est mieux assurée dans les pays prospères. En tuant la prospérité on tue la liberté et l’absence de liberté tue la prospérité et ce sont les objectifs initiaux qui s’éloignent : le niveau de vie des plus modestes régresse, le système de soins se dégrade, l’éducation patine, la justice disperse ses moyens…