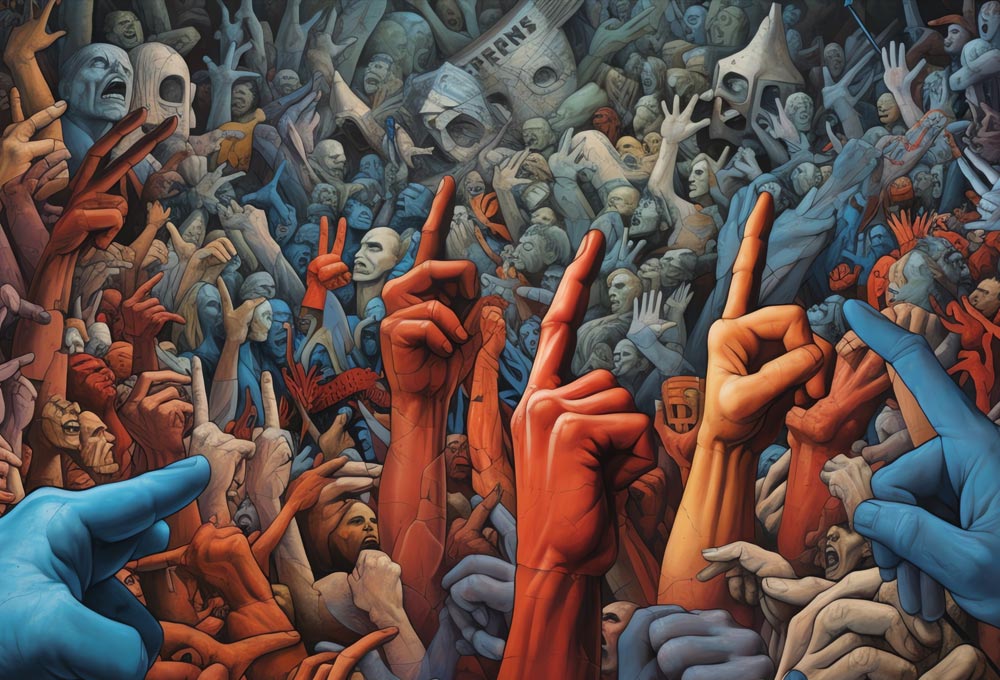La problématique qui agite la société française à propos de la retraite repose sur des projections statistiques globales en matière de démographie, de travail et d’économie, aveugles à la réalité micro économique dont l’importance est au moins aussi grande. C’est une erreur souvent commise que d’organiser une action en fonction de ce que l’on sait, c’est-à-dire d’une fraction seulement de la réalité : c’est ignorer le principe de précaution.
La retraite n’est pas seulement un chèque mensuel, c’est une part importante de la vie qui est largement déterminée par tout ce qui la précède et parfois la suivra, c’est-à-dire l’origine, la formation, la situation de famille, le patrimoine de chaque personne…
Pour une moyenne donnée, des problèmes différents se posent selon que la population considérée est homogène ou non. Avoir des pauvres d’un côté et des riches de l’autre pose des problèmes différents de ceux d’une population homogène de gens aisés, même si la moyenne des deux groupes est identique. La population des retraités comme celle des actifs n’est pas homogène : elle comporte des personnes contraintes de travailler et des personnes qui sont heureuses de le faire. Le groupe des retraités n’a pas une structure homothétique de celle des actifs : les femmes y sont 20 % plus nombreuses et les titulaires d’emplois difficiles moins nombreux en raison de leurs espérances de vie relatives. Les femmes ont des retraites moindres du fait du handicap que constitue la maternité pendant leur carrière et de l’hystérésis importante de leur rémunération par rapport à celle des hommes. La politique nataliste du gouvernement interfère avec cette situation : les aides à la maternité sont efficaces dans les milieux populaires uniquement si elles compensent correctement les pertes de salaire et, dans les milieux plus favorisés, si elles réduisent les contraintes matérielles que fait peser l’existence d’enfants sur une carrière, en particulier dans le cas de mères célibataires.
Perspectives démographiques
Contrairement à l’affirmation selon laquelle il est facile de prévoir avec un degré élevé de confiance les évolutions démographiques, celles-ci sont entachées d’incertitudes. Au niveau mondial, les Nations Unies ont revu plusieurs fois en vingt ans et de manière substantielle leurs prévisions pour la fin du siècle par exemple. En France même, le taux de fécondité tombé à 1,7 enfants par femme dans les années 80 est repassé au-dessus de 2 dans les années 90 puis est retombé récemment au-dessous de 1,60. Il a donc une forte volatilité. Elle existe également sur l’espérance de vie. Celle-ci a augmenté de six ans depuis 1980, mais le COVID a montré sa sensibilité aux pandémies. Le changement climatique, de nouvelles pandémies, des difficultés économiques persistantes, l’arrivée en fin de vie de personnes ayant connu de graves addictions, le développement de pathologies nouvelles liées à l’âge et de problèmes de santé mentale pourraient être à l’origine d’une régression. Le nombre de personnes vivant seules modifie également les besoins des retraités. On sait que l’Insee calcule le niveau de vie en considérant que 2 personnes vivant séparément ont des besoins financiers supérieurs aux besoins de 2 personnes vivant ensemble par exemple. La croissance du nombre de personnes isolées augmente le besoin du nombre de logements, tout en réduisant celui de leur surface moyenne.
L’immigration est également un facteur important des équilibres futurs : elle dépend de décisions politiques. L’humeur aujourd’hui hostile de l’opinion publique se retournera vraisemblablement quand sera constatée l’impossibilité de trouver quelqu’un pour pousser nos fauteuils roulants. D’ores et déjà la totalité du personnel de maison est d’origine étrangère et il en est de même dans les cuisines des restaurants et largement dans les hôpitaux.
L´évolution du travail
La modification dans le temps de la structure des emplois a pu être ignorée tant qu’elle était favorable : après les 30 Glorieuses, le nombre d’emplois qualifiés et de cadres a explosé et celui des ouvriers s’est contracté, ce qui a rendu simple le financement de la retraite des seconds. Un consensus s’établit aujourd’hui selon lequel, du fait de la robotisation et de l’intelligence artificielle, la structure des emplois pourrait se renverser au détriment des emplois intermédiaires et au profit des moins qualifiés et du chômage, c’est-à-dire des transferts sociaux. Comment des revenus modestes financeraient-ils des retraites d’anciens salariés plus qualifiés ? Par ailleurs, l’intelligence artificielle risque de rendre moins nécessaire le travail humain, certains auteurs annonçant même l’arrivée d’un chômage massif. Or la productivité est à l’origine de l’amélioration du sort des hommes, mais si elle tend vers l’infini, ils deviennent inutiles. Il est évident qu’il n’existera jamais une population totalement oisive et sans revenu à côté d’un appareil de production totalement autonome qui n’aurait aucun client et serait d’ailleurs vite détruit. Un nouvel ordre des choses serait créé, l’essentiel de la population étant alimenté à partir de transferts sociaux de type revenu universel. Il n’y aurait plus de distinction entre activité et retraite. Les seuls problèmes seraient de répartir la production et d’occuper la population : panem et circences.
Des auteurs comme la philosophe Simone Weil ont insisté sur le caractère nécessaire du travail à l’équilibre et à la dignité de la personne ; c’est confondre activité économique contrainte et occupation sociale : les citoyens d’Athènes ne travaillaient pas et c’était déroger pour la noblesse d’ancien régime que d’avoir besoin de le faire : pour autant, ni les uns ni les autres ne semblent en avoir souffert. Faire société implique des initiatives, des actions que des ordinateurs ne peuvent décider et exécuter à notre place et c’est de ça dont les hommes ont besoin, que ce soit dans une activité économique ou autre.
La formation
La formation des jeunes coûte cher à la société ; un minimum est obligatoire pour tous. L’enseignement supérieur constitue pour ceux qui en bénéficient, une période de la vie considérée le plus souvent comme agréable : elle retarde l’entrée dans la vie active, donne accès à des emplois plus gratifiants et à une meilleure retraite. Compte tenu du problème d’équilibre des retraites, que les moins favorisés sont mal placés pour contribuer à régler, l’enseignement supérieur pourrait être facturé à ses bénéficiaires sous la forme d’une pantoufle comme à polytechnique ou à Normale Sup lorsque leurs élèves n’entrent pas dans les corps de l’État en vue desquels ils ont été préparés. Cette pantoufle pourrait prendre la forme d’une cotisation alimentant, notamment, les retraites des catégories n’ayant pas bénéficié de cet enseignement supérieur.
Travail et retraite
Si certains revendiquent une retraite précoce pour des raisons personnelles, c’est surtout la nature du travail qui le justifie. Certains emplois sont désirés parce qu’ils comportent des activités présentant de l’agrément, un intérêt intellectuel ou suscitent un sentiment d’utilité et/ou bénéficient de reconnaissance et d’un statut social. D’autres n’ont aucune de ces caractéristiques positives. Il est impossible de changer totalement la situation : l’état des besoins et les avancées de la technologie ne peuvent changer le fait qu’il y aura toujours davantage besoin d’aide-soignants que de présentateurs de télévision ou de joueurs de football professionnels et une demande d’emploi inverse. La technologie a cependant beaucoup changé les choses et va continuer à le faire. Les syndicats demandent qu’il soit tenu compte de la pénibilité des emplois dans la date de départ à la retraite. C’est légitime mais insuffisant. S’il n’est plus nécessaire de recourir à des bagnards pour casser les pierres en vue de construire des routes, il n’en reste pas moins que manier toute sa vie un marteau-piqueur use le corps, stérilise l’esprit, raccourcit l’espérance de vie sans apporter aucun élément d’épanouissement personnel. Pour autant ce type d’emplois reste indispensable à la société : il faut poursuivre leur automatisation et y substituer chaque fois que c’est possible des robots. Il est par exemple profondément différent de balayer par tous les temps les rues de la cité avec un balai ou d’être l’opérateur responsable d’un engin moderne, couteux, esthétique, confortable, insonorisé pour faire le même travail en plus efficace. Il faut également faciliter les reconversions. Tous les jobs d’exécution ne sont pas nécessairement exténuants et abrutissants, loin de là. Il faut également supprimer la frontière entre travail et retraite pour que le maximum de personnes puisse bénéficier des avantages extra économiques que sont un sentiment d’utilité et une insertion sociale satisfaisante ainsi qu’une certaine occupation du temps disponible pour ne pas conduire à l’oisiveté totale. Celle-ci est particulièrement néfaste pour les personnes ne disposant pas de revenus suffisants pour pratiquer les activités de loisirs des classes moyennes et supérieures.
La retraite pourrait être l’occasion de participer à un service civil communal pas trop exigeant et faiblement rémunéré en sus de la retraite pour effectuer des missions d’intérêt collectif de plus en plus nécessaires et de moins en moins finançables, sorte de retour des corvées d’autrefois, l’obligation témoignant de leur utilité sociale et son application à tous, sous réserve de l’état de santé, confortant le lien démocratique.
Le patrimoine
Il est évident que les retraités disposant d’un patrimoine sont dans une situation meilleure que les autres, en particulier les propriétaires de leur logement. Par ailleurs, on évoque fréquemment l’idée de retraite par capitalisation. Cette expression technique trompe quelque peu sur la relation entre retraite et patrimoine : tous les revenus perçus à un moment quelconque de la vie, et donc pendant la retraite, sont prélevés sur le revenu national, c’est-à-dire la production des actifs. Le système, dit par capitalisation, se distingue par la nature des cotisations qui visent à constituer une épargne et non à alimenter une répartition immédiate ; la rente est alimentée par des produits financiers, dividendes ou intérêts. La capitalisation ne peut se substituer brutalement à la répartition, car aucune génération ne serait capable d’assumer les retraites par répartition de la génération antérieure et de constituer l’épargne nécessaire à la sienne. Elle a le mérite de mettre plus en évidence la relation entre ce que chacun doit prélever sur ses revenus en vue de sa retraite et ce qu’il percevra, mais ce message est obscurci parce qu’une péréquation reste nécessaire, que la valorisation de l’épargne dépend très fortement de la fiscalité et qu’une intervention de l’Etat s’imposerait de toute manière en cas d’hyperinflation. Rappelons qu’entre 1939 et 1950 le patrimoine financier des ménages a perdu 80% de sa valeur. L’avantage principal d’un tel système serait de caractère macro-économique : il augmenterait l’épargne disponible pour financer l’investissement et créerait un lien avec le PIB plutôt et pus seulement avec le travail.
Des perspectives existent cependant, liées au cycle de vie et au fait que ce qui est improprement appelé retraite par capitalisation est en réalité, dans la phase de liquidation, une décapitalisation. Compte tenu de l’espérance de vie actuelle, le patrimoine d’une génération passe à la suivante alors que cette dernière est elle-même proche de la retraite. Par ailleurs, le patrimoine de beaucoup de personnes s’est constitué avec des aides publiques, prêts à taux 0%, épargne logement, PEA etc. Les noms et les formules changent avec le temps mais l’existence de ces dispositifs est permanente. Par ailleurs, la constitution d’un patrimoine utilisable comporte des avantages qui rendent l’effort plus acceptable qu’une cotisation à fonds perdus. Pour toutes ces raisons, introduire la propriété d’un bien immobilier dans la problématique de la retraite apparaîtrait légitime. D’ailleurs 70 % des retraités sont d’ores et déjà propriétaires de leur logement et ce pourcentage pourrait, dans l’intérêt général et en particulier des plus modestes, être accru. Dans cette perspective, les caisses de retraite et compagnies d’assurance pourraient faciliter l’acquisition de logements et garantir leur affectation à la retraite. Il serait également souhaitable qu’il soit remédié à une anomalie fiscale qui crée une inégalité injustifiée entre les contribuables, freine l’acquisition de logements et crée une inégalité économique au moment de la retraite, à savoir que les personnes appelées à des mobilités professionnelles, ne peuvent posséder un bien principal et le donner en location quand elles ne l’occupent pas et déduire du loyer qu’elles perçoivent de ce bien celui qu’elles payent pour se loger. L’acquisition d’un logement est économiquement attrayant, mais également moralement, car il nourrit un sentiment de sécurité et supprime le stigmate social résultant de la non propriété dans un pays où la majorité est propriétaire. Ce complément de retraite à base immobilière pourrait prendre plusieurs formes : l’une totalement privée impliquant les compagnies d’assurance et l’autre passant par les institutions de prévoyance en lien avec les organismes de logement social. La première voie viserait à faciliter la pleine propriété, la seconde à l’acquisition d’un droit d’occupation viager pendant la retraite dans un logement du parc social.
Le souci de préparer l’avenir est légitime : on a vu, avec le numerus clausus dans le domaine de la santé, les difficultés insurmontables qu’’entraîne l’attitude inverse. Il ne faut cependant pas faire comme s’il était possible de tout prévoir. Dans un environnement fluctuant, prétendre déterminer l’avenir de manière rigide pour près d’un siècle est une gageure vouée à l’échec. Il est nécessaire de poser quelques principes dont le fait de ne pas dépendre exclusivement d’une seule variable telle que l’emploi, que la retraite ne doit pas constituer la mise à l’écart total de la population active, que l’aide de la collectivité sera assurée en contrepartie d’un rôle actif et responsable dans la préparation par chacun de son avenir mais surtout, que la situation doit être revue très régulièrement sans attendre que les effets de nouvelles tendances ne soient devenus ingérables.